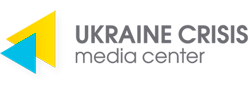Quel est le rôle de la Belgique dans la “coalition des volontaires” européenne? Comment traîter les avoirs russes gelés en Belgique? Quelle est l’opinion publique belge sur la guerre russe en Ukraine et quelles sont les priorités de l’aide belge pour l’Ukraine? Dans les locaux de Ukraine Crisis Media Center à Kyiv nous rencontrons Luc Jacobs, Ambassadeur de Belgique en Ukraine. Luc Jacobs vient de commencer sa deuxième mission d’ambassadeur en Ukraine, il a dirigé l’ambassade de 2014 à 2018 et a vu de ses propres yeux le début de l’agression russe contre l’Ukraine. Il accorde cet entretien à Tetyana Ogarkova, responsable du département international.
Votre Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, merci beaucoup d’avoir accepté notre invitation et nous accorder cet entretien. Ce n’est pas la première fois que vous êtes ambassadeur de la Belgique ici, en Ukraine. Nous nous rappelons très bien de votre présence en Ukraine déjà dans les années 2014-2018. Et vous êtes de retour en tant qu’ambassadeur de la Belgique ici en Ukraine depuis fin 2024. Comment la société ukrainienne a-t-elle changé entre vos deux séjours en Ukraine ?
Tout d’abord, merci beaucoup de m’avoir invité, et en effet, d’avoir rappelé que c’est ma deuxième mission dans votre pays. Comment j’ai ressenti la différence ? Il est clair que revenir en Ukraine en ce moment précis, c’est revenir dans une Ukraine — et à Kyiv — dans des circonstances dramatiquement différentes. Mais la sensation que j’ai, c’est que la dynamique profonde de la société ukrainienne est restée la même.
Je constate que la société ukrainienne est encore plus résolument tournée vers son avenir, vers son retour dans la famille européenne et euro-atlantique. Et l’agression russe, je dirais, est une tentative désespérée mais futile de nous distraire de cette trajectoire. Et je dis «nous» non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour nous-mêmes, la Belgique et les partenaires européens et euro-atlantiques.
Vous êtes à Kyiv tout autant que les Ukrainiens qui y vivent: comment la vie est-elle devenue différente après la grande invasion russe, avec les alertes aériennes, avec le danger qui reste présent ? Comment se sent-on dans la capitale d’un pays en guerre?
Avant d’arriver ici, je me suis posé cette question. Il y avait quand même une certaine nervosité. Je me suis dit : «Je vais rentrer dans quel type d’ambiance? Quel type d’atmosphère?». Est-ce que, en effet, la menace des drones, des missiles, va vraiment peser sur moi ? Et à ma grande surprise, j’ai constaté — je crois que c’est surtout la façon dont se comportent les Ukrainiens autour de moi — cela m’a tout à fait rassuré, tout à fait mis à l’aise. En fait, j’ai un peu suivi le rythme des Ukrainiens et des Ukrainiennes.
Et au niveau de la vie quotidienne, disons à Kyiv, la ville où j’habite, je dirais qu’on pourrait parler d’une normalité anormale. Mais il y a une certaine normalité, en même temps.
Oui, il y a des inquiétudes. Je vois autour de moi, aussi, parmi mes collègues ukrainiens, qu’il y a une différence de perception. Pour eux, étant ici avec leurs familles, leurs enfants, c’est une autre façon de vivre la situation que pour moi, qui suis venu sans ma famille. Je n’ai pensé qu’à moi-même et je peux, peut-être, de cette manière-là, me sentir un peu plus confortable.
Ce qui m’a frappé énormément dès mon arrivée, c’est l’engouement pour la culture. J’ai tout de suite, parmi mes anciennes connaissances, été invité à des festivals, à des concerts. Et là, j’ai constaté que, pour les Ukrainiens, la culture, dans ses différentes expressions, est aussi une forme de résistance. Et ça m’a particulièrement impressionné. Cela contribue aussi à la façon dont je me sens bien dans la ville, parce que la vie culturelle existe. Parce que les Ukrainiens, en fait, vivent la guerre qui cherche non seulement à détruire les villes, les villages, les gens, mais tout aussi bien ce qui relève de l’identité ukrainienne. La culture est donc une manière de s’affirmer, malgré cela. C’est évident, et c’est un effet très positif.
Comment voyez-vous la société belge réagir à cette guerre en Ukraine? Quelle est l’évolution depuis 2014 et jusqu’à aujourd’hui, en 2025?
Je crois qu’en 2014, l’opinion publique n’était pas tellement impliquée ou intéressée par ce qui se passait en Ukraine. Et cela a drastiquement changé avec l’invasion de 2022. On peut dire qu’avec cette invasion, tout ce qui avait été un peu occulté depuis 2014 — c’est-à-dire l’implication directe de la Russie pour déstabiliser le pays, déstabiliser l’Ukraine — a été mis en lumière. Une guerre par procuration, comme on dit. Je crois que la Russie, à ce moment-là, a réussi à semer la confusion, aussi par la désinformation, mais avec l’invasion, tout est devenu très clair. Une agressivité, et aussi la volonté d’anéantir l’Ukraine en tant qu’État indépendant, d’anéantir l’Ukraine dans son identité, sa culture, son héritage culturel, son histoire.
La population belge a bien remarqué cela, évidemment. L’attention pour la guerre a évolué, selon aussi ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, c’est une guerre beaucoup plus médiatisée aujourd’hui. Mais il n’y a pas uniquement le facteur distance. En Belgique, on est un peu plus loin de cette guerre, par exemple, que dans les pays voisins de l’Ukraine. Mais il y a aussi le facteur temps. Plus cette guerre dure, plus il y a une certaine fatigue, peut-être. Mais ce que je remarque aussi, c’est que, dans tous les cas, les médias en Belgique parviennent mieux à expliquer ce qui se passe en Ukraine, et aussi à faire comprendre qu’il y a une communauté ukrainienne en Belgique. Il y a plus ou moins 90 000 Ukrainiens et Ukrainiennes temporairement déplacés en Belgique.
Donc cette présence d’une communauté ukrainienne compense un peu la distance et est beaucoup plus présente et visible en Belgique. Cela fait que les Belges restent attentifs à ce qui se passe en Ukraine. Ils comprennent mieux la géographie de l’Ukraine, connaissent mieux la culture ukrainienne. Ils sont beaucoup plus familiarisés avec l’Ukraine. Et ça, je crois que c’est une grande différence par rapport à 2014.
Nous parlons en mars 2025, et la guerre à grande échelle dure déjà plus de trois ans, et nous voyons des changements géopolitiques majeurs, notamment après l’arrivée de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis. L’Europe, en tant que communauté de pays différents, semble plus inquiète, après certaines déclarations américaines. Nous parlons de plus en plus de la solidarité européenne qui serait nécessaire pour renforcer la défense ukrainienne dans cette guerre. Quel est le rôle de la Belgique dans ce qu’on appelle aujourd’hui «la coalition des volontaires»?
Je voulais d’abord peut-être nuancer quelque peu ce que je disais sur la fatigue, la fatigue en ce qui concerne l’attention constante que l’opinion publique porte à l’Ukraine. Et donc, fonction du temps, car la guerre dure déjà, et c’est aussi une tactique de fatiguer non seulement les Ukrainiens, mais aussi l’opinion publique dans les pays partenaires de l’Ukraine. Mais ce que je remarque en Belgique, c’est quand même beaucoup de sympathie et d’empathie pour la cause ukrainienne, car les Belges peuvent facilement se projeter dans ce que c’est ancré dans leur mémoire collective, ce que nous, Belges, avons subi au siècle dernier. Nous avons connu deux invasions massives, et cela a créé, dans l’esprit et dans les émotions des Belges, une connexion particulière à la cause ukrainienne. Ils peuvent s’identifier à cette situation, et je crois que ce sentiment est très marqué aujourd’hui.
Quand on arrive dans une phase où on parle de terrain pour arriver à un cessez-le-feu, un accord de paix, etc., mais que l’opinion publique constate que ce serait plutôt une paix ou un cessez-le-feu forcé sur l’Ukraine, on verra tout de suite que cette solution serait inacceptable pour l’Ukraine. On dirait “écoutez, ce n’est pas comme ça qu’on crée les conditions pour un cessez-le-feu qui tienne”, pour ne pas encore parler d’une paix durable. Cela, c’est un élément et un sentiment que je constate, aussi, en parlant avec des amis, des connaissances, en lisant des commentaires dans les médias.
Bon, avec les changements géopolitiques, géostratégiques que vous avez mentionnés, en tous les cas, le réflexe en Europe est, en effet, de serrer les coudes et de prendre conscience des responsabilités que nous devons prendre par rapport à notre sécurité, à notre défense, tout en réalisant que la première ligne de défense est en Ukraine. Je constate aussi en Belgique qu’il y a, avec l’avènement d’un nouveau gouvernement, que cette décision a été prise : nous devons absolument accélérer nos dépenses de défense pour atteindre le fameux 2 % du produit intérieur brut. Et il est dans notre intérêt de continuer à soutenir militairement l’Ukraine, justement parce qu’il s’agit de notre défense, de notre première ligne de défense, la défense de nos démocraties et de nos valeurs, qui sont ici, en Ukraine. L’Ukraine est un bouclier qui se défend non seulement elle-même, bien sûr, mais aussi toute l’Europe, de manière plus directe pour certains pays comme la Pologne et les États baltes. Mais derrière le projet de Poutine, il est très clair qu’il veut remettre en question tout le monde libre et démocratique. Et même si le sentiment de danger n’est pas imminent à Bruxelles, on peut facilement imaginer qu’on ne pense pas à la guerre quand on est à Bruxelles, mais cela peut changer.
Voilà, donc encore quelques précisions concernant cette nouvelle donne géopolitique. Nous avons du mal à saisir, à cerner en fait le projet géopolitique américain. Il est flou, il n’est pas clair ce que veut exactement cette nouvelle administration américaine, avec Donald Trump en tête. Est-ce que la Belgique croit que le parapluie de sécurité, projeté depuis les États-Unis vers l’Europe, qui protégeait en quelque sorte l’Europe dans le cadre de l’OTAN, ce projet pourrait en effet arriver à sa fin, très prochainement ?
C’est un moyen de clarifier les choses et de mettre les choses au clair. Je crois que les messages donnés par l’Europe actuellement ne laissent aucun doute sur l’identité de l’agresseur dans cette guerre. Il n’y a aucun doute sur la menace que représente l’agression russe contre l’ordre international. Il n’y a aucun doute concernant notre devoir de préserver l’ordre juridique international et le système du multilatéralisme. Je crois que l’Europe est en train de projeter cette clarté et réussit bien à la faire passer, et la Belgique s’inscrit pleinement dans cet effort. Concernant l’avenir du lien transatlantique, au moment où l’on se parle, je suis relativement rassuré. Ce lien transatlantique, qui a une longue histoire, est marqué par des réussites et une relation bien soudée, fondée sur un intérêt mutuel des deux côtés de l’Atlantique. Je ne crois pas que ce lien transatlantique puisse être coupé ainsi. Il y a un langage fort, mais je crois que, dans la réalité, les partenaires des deux côtés de l’Atlantique savent très bien ce que cela signifie pour l’un et l’autre.
On garde l’espoir, tant du côté ukrainien que du côté des États-Unis, que le soutien à la cause ukrainienne, qui existe depuis le début, restera inébranlable, malgré cet épisode dramatique. En effet, lorsque l’administration américaine avait coupé littéralement l’aide militaire qui avait été décidée sous la présidence de Joe Biden après l’échange des renseignements, cela avait été un geste qui ne suscitait pas confiance. Cela est vrai aussi, mais on espère que cette unité persistera. En mars 2025, on espère que cette unité restera intacte, car elle est dans l’intérêt des deux parties de rester unis et ensemble.
La Belgique a beaucoup aidé l’Ukraine depuis février 2022, à travers une aide économique, militaire et humanitaire. Mais aujourd’hui, on entend de plus que, même si l’on garde l’espoir de l’unité transatlantique, l’Europe devrait viser une certaine autonomie de défense, un degré d’autonomie militaire qui est important. La Coalition of the Willing, cette nouvelle unité de pays européens, existe. Comment la Belgique envisage-t-elle de renforcer cette composante militaire de l’aide à l’Ukraine?
Vous avez fait référence à la dernière réunion à Paris de cette Coalition of the Willing. La Belgique y a participé, en particulier parce qu’elle a envoyé des signaux forts concernant son engagement à augmenter drastiquement ses dépenses de défense. En même temps, la Belgique comprend que notre défense se joue directement sur le territoire ukrainien. Nos efforts dans ce domaine vont certainement inclure un soutien militaire accru pour l’Ukraine. Notre Premier ministre l’a d’ailleurs exprimé après les réunions à Paris, en soulignant que l’autonomie de défense inclut également notre soutien à l’Ukraine, qui fait partie de cet espace européen que nous défendons. Il a également déclaré que chaque euro investi dans la défense de l’Ukraine est un euro bien investi. Il est donc certain que la Belgique a la volonté de continuer, voire d’augmenter son soutien à l’Ukraine dans le domaine militaire, et également dans le cadre de la coopération entre industries de défense, où des projets concrets sont déjà en cours. La Belgique est donc pleinement engagée dans cet effort pour rendre l’Ukraine plus forte, afin d’atteindre la paix par la force.
Lorsqu’on parle de la Belgique, il y a souvent cette question complexe concernant le gel des avoirs russes. Plusieurs centaines de milliards d’euros d’avoirs russes sont gelés dans les banques belges. On sait que les intérêts des avoirs gelés sont déjà utilisés ici en Ukraine pour renforcer la défense ukrainienne. Mais il y a une grande question: est-ce qu’on peut utiliser cette somme pour financer l’Ukraine, pour financer la défense, ou bien pour financer la reconstruction après la guerre? Alors, où en sommes-nous aujourd’hui avec ces débats ? Quelle est la position de la Belgique sur cette question?
Aujourd’hui, oui, comme vous l’avez dit, c’est une question très complexe, et puisque l’on me pose souvent cette question, je l’ai évidemment étudiée de façon plus approfondie. J’ai d’abord découvert que les 190 milliards d’euros ne sont pas des avoirs gelés, mais des avoirs immobilisés. Il y a une différence entre des avoirs gelés et des avoirs immobilisés. Je ne savais pas non plus ce que cela signifiait. Mais qu’est-ce qu’on veut dire par “immobilisé” ? Tout d’abord, ces avoirs n’appartiennent pas à la Belgique, ils sont déposés dans une institution financière située sur le territoire belge. Mais dans le cadre des sanctions, ils ont été immobilisés. Immobiliser signifie que ces avoirs ne peuvent plus faire l’objet de transactions, par exemple avec la Banque nationale russe. Ces transactions sont donc suspendues. La différence entre avoir gelé et avoir immobilisé n’est pas théorique, elle a des conséquences légales importantes. Les avoirs gelés concernent des personnes physiques sous sanction, tandis que, dans ce cas, il s’agit des avoirs liés aux transactions de la Banque nationale russe.
Comme vous l’avez dit, il s’agit d’un montant très important, mais ces avoirs génèrent de l’argent, des intérêts. Ces intérêts ont déjà été utilisés au profit de l’Ukraine, et plus récemment dans le cadre d’un mécanisme de prêt mis en place par le G7. Ce mécanisme consiste à donner des prêts à l’Ukraine pour combler les lacunes dans son budget et permettre à l’Ukraine de maintenir l’effort de guerre. Ces intérêts sont donc pleinement utilisés pour cela, pas uniquement par l’Union européenne, mais aussi par les autres membres du G7. Le système a été mis en place grâce aux contributions des experts belges, qui ont participé au développement de ce mécanisme.
Les avoirs produisent donc des intérêts, et cet argent est entièrement utilisé pour répondre aux besoins budgétaires de l’Ukraine. Si l’on décidait de confisquer ces avoirs, cela signifierait se priver de cette source de financement, et nous n’aurions plus l’occasion d’aider l’Ukraine dans ce cadre de manière soutenue et durable. Ce serait comme tuer le poulet aux œufs d’or. Cependant, confisquer ces avoirs, même le capital, n’est pas sans risques, notamment juridiques, et il existe un risque pour la stabilité financière de la zone euro. Lorsque l’on met en balance les risques de confisquer ces avoirs, il faut aussi prendre en compte que les avoirs restent gelés, ce qui constitue une sanction. Les sanctions ne seront pas levées tant que la Russie persiste dans son agression. Elles ne sont pas négociables, comme l’Europe l’a clairement indiqué.
Si la Russie persistait à demander la levée des sanctions comme condition pour un cessez-le-feu, nous ne serions pas du tout d’accord avec cette approche. Les sanctions sont maintenues tant que l’agression russe continue.
Le gel ou l’immobilisation des avoirs est une sanction qui reste en vigueur. En même temps, l’argent généré est utilisé au profit de l’Ukraine. Donc, nous ne changeons pas cette situation pour l’instant. La Belgique n’est pas isolée dans ce point de vue, le dernier Conseil européen a en fait créé cette position, visant à sauvegarder cette somme tout en conservant l’influence sur les sanctions contre la Russie. Il reste cependant le problème de l’argent et de garder un levier pour, un jour, exiger de la Russie qu’elle paie des réparations pour tous les dommages qu’elle a causés. La question de la facture de la reconstruction revient à la Russie de la payer, et avec ses avoirs russes toujours immobilisés, nous aurons un levier pour forcer la Russie à répondre de son agression. Ce qu’il faudra faire, même si cela ne se produira pas demain ou la semaine prochaine. Nous comprenons tous que, un jour, nous aspirons à une paix juste, et une paix juste signifie aussi que l’agresseur, la Russie, devrait au moins compenser pour tous les dégâts qu’elle a causés.
Un autre dossier sensible concerne les avions de chasse F-16. La Belgique fait partie de cette coalition de pays qui ont promis de livrer des F-16 à l’Ukraine, des avions de chasse très nécessaires ici pour défendre le territoire, abattre des missiles, protéger les zones sensibles, etc. Un certain nombre de F-16 ont été promis par la Belgique, mais il y a une certaine pause dans l’envoi, car il existe un problème du côté américain. En effet, la Belgique, comme d’autres pays européens, doit remplacer ses F-16 par des F-35, avant de pouvoir envoyer les F-16 en Ukraine. La question est simple: où en sommes-nous aujourd’hui ? Où sont les F-16 et quand l’Ukraine pourra-t-elle espérer recevoir ces avions, qui font déjà partie du paquet d’aide militaire belge ?
La Belgique fait partie de cette coalition de pays qui ont déjà livré et vont livrer des F-16 à l’Ukraine. Dans cette coalition, les pays se répartissent les tâches. Ceux qui étaient déjà en position de fournir des F-16 l’ont fait. Le rôle crucial de la Belgique est de veiller à ce que ces F-16 puissent être utilisés de manière efficace. Cela nécessite des pilotes formés, des pièces de rechange, et de la maintenance. La Belgique intervient dans ce domaine pour garantir que les F-16 soient véritablement opérationnels.
Ces F-16 seraient livrés au fur et à mesure de leur remplacement par les F-35. Il faut savoir que dans l’accord de sécurité que la Belgique a signé avec l’Ukraine, la date butoir pour le remplacement graduel des F-16 par les F-35 était initialement prévue pour 2028. Cependant, il est très probable que la Belgique puisse déjà fournir des F-16 cette année, notamment pour des pièces de rechange. La livraison des avions opérationnels pourrait commencer dès 2026, soit deux ans avant la date prévue de 2028. Je ne parlerais donc pas de retard dans la livraison. La Belgique respecte pleinement ses engagements au sein de la coalition. Bien entendu, il n’est pas logique de stocker des F-16 en Ukraine, où ces avions seraient beaucoup plus vulnérables et ne pourraient pas être utilisés faute de pilotes formés ou de maintenance.
Vous êtes ambassadeur de la Belgique en Ukraine et votre deuxième mandat vient de commencer. Quelles priorités dessinez-vous pour vous-même pour les années à venir?
La grande priorité est évidemment de faire ma modeste contribution pour que la Belgique puisse être aussi utile que possible dans l’effort européen, dans l’effort de l’OTAN et dans l’effort multilatéral, pour faire en sorte que l’Ukraine obtienne ce qu’elle aspire à obtenir, et ce que tout le monde aspire: une paix juste et durable. Cela passera par la continuité des grands efforts que la Belgique a déjà consentis, au niveau de l’aide militaire et de l’aide humanitaire, entre-temps, la Belgique a également mis en place un programme de 150 millions d’euros, qui constitue notre contribution à la reconstruction et à la relance de l’Ukraine. Ce programme est mis en œuvre par notre agence Inabel. C’est un travail qui s’étale sur quatre ans, une manière de coopérer très concrètement avec les Ukrainiens à tous les niveaux, tant au niveau central qu’au niveau local et régional. C’est un programme d’envergure qui devra être suivi de très près.
Il y a aussi, évidemment, tout un travail à faire au niveau de la coopération entre nos entreprises. J’ai déjà constaté que la plupart de nos entreprises, qui étaient établies en Ukraine avant l’invasion, sont toujours présentes en Ukraine et restent actives. Elles ont souffert pendant l’invasion, elles souffrent sous les attaques, et elles vivent avec l’incertitude. Mais elles font preuve de beaucoup de résilience. Nous avons donc une communauté d’affaires présente en Ukraine, qui, pour moi, est un outil très intéressant à développer davantage. Ces relations doivent être renforcées, tant en termes d’investissements, de commerce, que de coproduction. Ce n’est pas uniquement dans le domaine de la défense, mais justement il y a une priorité : renforcer notre capacité de défense et renforcer les capacités de l’Ukraine. Et bien sûr, nous le faisons aussi à travers des coproductions. C’est clairement l’une des priorités de mon travail en ce moment.