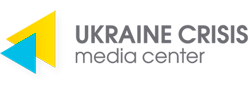Comment la guerre influence-t-elle la construction nationale en Ukraine? Quel rôle de la mémorialisation pendant le conflit?
Pour parler de ces sujets nous rencontrons Alexandra Goujon, maître de conférences à l’Université de Bourgogne. Alexandra est l’auteure de deux livres sur l’Ukraine dont L’Ukraine, de l’indépendance à la guerre (2021). Elle vient de soutenir son habilitation à diriger des recherches sur le nationalisme et la mémorialisation en Ukraine.
Alexandra, tu suis l’évolution de l’Ukraine depuis 1996. Nous sommes en guerre depuis 2014. Nous sommes aussi dans cette étape de la Grande Guerre depuis plus de trois ans. Comment tu vois le moment présent, cette évolution de la conscience de soi, du nationalisme ukrainien, de l’importance de la mémoire, à quelle étape on se situe aujourd’hui ?
Ce que j’explique dans mon habilitation, c’est que jusqu’en 2014, on a affaire à un nationalisme à bas bruit, c’est-à-dire à un nationalisme qui suit son cours, une construction nationale qui suit son cours, sans beaucoup de crises, à l’exception bien évidemment de la Révolution Orange. Alors, la Révolution Orange n’est pas tout à fait considérée comme une révolution nationale, on va dire au départ, mais bien évidemment elle prend tout son sens après avec la Révolution de la dignité, et on s’y réfère parce que, finalement, la Révolution Orange est une victoire, une victoire de la démocratie sur l’autoritarisme, mais aussi une victoire en termes de construction nationale, et aussi de construction mémorielle.
On se souvient de ce que j’appelle la mémorialisation chaude, autour de la famine ukrainienne de 1932-1933, avec cette mémorialisation: un musée, un monument, des monuments dans l’ensemble de l’Ukraine. Alors, avec 2014, on a une nouvelle étape: l’annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbas, que j’appelle donc “la guerre limitée avec la Russie”, limitée parce qu’elle est limitée à un territoire, et elle concerne quand même beaucoup moins de personnes que l’invasion à grande échelle de 2022, où là, la résistance nationale devient nationale parce qu’elle couvre l’ensemble du territoire.
On voit une résistance qui existe, qui se fait par réseaux de soutien armé, de soutien aux réfugiés, aux déplacés internes, etc. Et puis, on a des mouvements identitaires, avec une Russie qui est considérée comme un pays ennemi, un pays agresseur; toute la rhétorique autour de l’amitié des peuples, la fraternité, disparaît et est balayée.
Et puis, le rapport à la langue change. J’ai encore eu des témoignages cette semaine, de personnes me disant: en 2022, jusqu’en 2022, je parlais deux langues — l’ukrainien au travail, le russe à la maison. Ma famille est passée à la langue ukrainienne à partir de 2022.
On a beaucoup de témoignages de ce type. Le rapport aussi à la culture ukrainienne. Et je tiens à le faire remarquer: souvent, par exemple en France ou dans tant d’autres pays d’Europe, on est frappés par ce phénomène qu’on appelle ici la dérussification, la décolonisation, le démontage des statues de Pouchkine, qui apparaît comme presque absurde. Et en fait, ici, la question n’est pas tant d’évincer la culture russe, elle est surtout d’évincer la culture russe impériale, ce qui donne du poids aujourd’hui à cette guerre, qui est une guerre coloniale et une guerre impériale du point de vue russe.
On voit également des cycles, puisque l’on se souvient de ce mouvement qu’on appelle les soixantards, c’est-à-dire Shistdesiatnyky, qui signifie en ukrainien «des années 60», où la répression est moins forte, et où on essaye, dans les canons culturels soviétiques, de faire une place en Ukraine à une spécificité, une différence culturelle nationale. Et d’ailleurs, c’est très intéressant de voir que ce mouvement, dont on a parlé dans les années 60, revient aujourd’hui, et justement pour reprendre une place aussi dans l’espace public qui a été donc russifié. Je veux dire dans le sens où je parle des statues de Pouchkine, mais ça peut être les rues Tolstoï ou d’autres artistes russes. Donc aujourd’hui, les Ukrainiens redécouvrent la littérature ukrainienne. Alors bien évidemment, on a toujours eu Taras Chevtchenko, qui n’a quasiment jamais été évincé. Il y a des monuments à Taras Chevtchenko dans toute l’Ukraine, mais en dehors de cela, il y a énormément d’artistes ukrainiens qui sont très peu connus.
Tu emploies le terme scientifique de “nationalisme chaud”, par opposition, en fait, au nationalisme ordinaire. Et tu dis que, à chaque étape — la Révolution Orange, la Révolution de la Dignité de 2013-2014, l’invasion de la Russie, l’annexion de la Crimée, la grande invasion russe en 2022 — à chaque étape la nation politique est en train de se forger, n’est-ce pas?
Alors, en fait, ça vient de la différence entre nationalisme froid — ou banal — et le nationalisme chaud. Elle vient donc d’un auteur qui s’appelle Michael Billig, et qui a forgé ce concept. Alors, lui, il a plutôt forgé le concept de nationalisme banal justement pour dire qu’on s’attache souvent seulement au nationalisme chaud. Et ce qu’il explique, c’est que le nationalisme chaud, c’est le nationalisme qui peut… alors, il y a deux significations. Ça peut être le nationalisme un peu radical, donc de groupes qui voient la nation comme quelque chose d’extrême, d’exclusif, ethnique. Et souvent, on se focalise sur ce nationalisme-là. C’est bien pour ça, d’ailleurs, que le mot nationalisme est souvent vu de manière péjorative.
En parlant de nationalisme banal, Billig s’intéresse à ce qu’il appelle donc le nationalisme banal, ou ce qu’on peut appeler le nationalisme ordinaire. Le nationalisme dans les nations installées comme, je ne sais pas, les États-Unis, la France, et où il montre qu’en fait, il existe un nationalisme banal. C’est un nationalisme de tous les jours, dont les personnes, les citoyens, ne prennent pas forcément conscience.
C’est quelque chose qui existe dans l’espace public. Par exemple, il parle des drapeaux américains qu’aujourd’hui, aux États-Unis, on ne remarque pas nécessairement et qui existent dans l’espace public peut-être beaucoup plus que dans d’autres pays. Ils montrent notre attachement lorsqu’on suit, par exemple, des commémorations nationales, etc.
Alors, le nationalisme chaud est souvent un nationalisme qui peut être vu comme extrême ou alors un nationalisme de crise. Et moi, c’est cette partie-là qui m’intéressait, sachant qu’elle est assez peu travaillée. Et ce que je trouve intéressant, c’est que là, en Ukraine, en ce moment, on a un nationalisme chaud dans le cadre d’une guerre. Donc c’est une crise très particulière, et ce n’est pas un nationalisme chaud qui est justement relié à un nationalisme extrême. Puisque, aujourd’hui, les changements identitaires dont je parlais: le rapport à la Russie, le rapport à la culture ukrainienne, le rapport à la langue ukrainienne, le rapport aux drapeaux — extrêmement important, les couleurs jaune et bleu.
Ce n’est pas ethnique. C’est un nationalisme chaud qui vise une construction nationale, qui met en avant la nation, mais dans ce qu’elle peut rassembler le plus possible de citoyens. Indépendamment de différences, par exemple religieuses ou de différences d’origine. J’ai eu des témoignages de gens m’expliquant en quoi leur parent était né en Russie, venu s’installer en Ukraine, et où il y a un attachement à la terre ukrainienne qui est extrêmement fort.
L’Ukraine était toujours, et est toujours, un pays avec plusieurs ethnies présentes, et il n’est pas question d’avoir que les Ukrainiens et les Russes. Il y a aussi des Juifs, il y a des Tatars de Crimée, il y a des Arméniens, il y a des Grecs. Au sud de l’Ukraine d’ailleurs, qui souffre aujourd’hui de l’occupation, il y a d’autres. Il y a les Karaïmes, par exemple, qui viennent de Crimée. Donc ce n’est pas ethnique, donc le nationalisme, c’est une vision de la nation politique. Mais qui, à la fois, comme tu dis, il est chaud, c’est-à-dire qu’il est enflammé.
Tout à fait, c’est-à-dire qu’en fait, ce nationalisme s’exprime notamment dans les moments les plus difficiles. Alors, c’est notamment après des bombardements, où il y a une espèce de soutien collectif, à la fois par rapport aux victimes, mais aussi aux survivants.
Donc il y a aussi un nationalisme chaud que je relie justement à ce que j’ai appelé, dans la continuité de cette conceptualisation, la mémorialisation chaude. Pourquoi? Parce que justement, on a une mémorialisation qui se fait en deux temps. On a la mémorialisation de la guerre elle-même, c’est-à-dire après des bombardements, après la découverte de charniers — Boutcha, Izium — comment on parle de ces bombardements, comment on rend hommage aux victimes. Et en même temps, on a une mémorialisation en temps de guerre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les processus mémoriels en Ukraine, qui existaient depuis l’indépendance, se transforment en lien avec la guerre. Un des exemples qu’on peut voir là, aujourd’hui, en ce moment, c’est la question du rapport entre le 8 mai et le 9 mai.
Aujourd’hui, nous sommes le 9 mai, date de commémoration de la Grande Guerre patriotique pendant la période soviétique, puis aujourd’hui en Russie. Et hier, nous étions le 8 mai. Le 8 mai, c’est donc la date de la commémoration en Europe de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c’est cette date qu’aujourd’hui, l’Ukraine a choisie pour commémorer, et on a eu un processus progressif du passage du 9 mai au 8 mai. On est d’abord resté sur le 9 mai très longtemps en Ukraine, puis après, on a rajouté le 8 mai, et progressivement, on a modifié la date pour qu’aujourd’hui, ce soit le 8 mai. Mais cela, ce n’est pas qu’une question de date, ça entraîne une transformation aussi du récit sur la Seconde Guerre mondiale.
Maintenant, ce n’est plus 1941-1945, mais c’est 1939-1945, on inclut le pacte Molotov-Ribbentrop. Et puis, pour parler des processus mémoriels, je vais donner un exemple. Hier, j’étais à l’ouverture d’une exposition en plein air au sein du musée d’histoire de la Seconde Guerre mondiale à Kyiv. Et cette exposition s’appelle Notre Victoire. Pourquoi? Parce qu’en fait, les Ukrainiens se rendent compte que le récit de la Seconde Guerre mondiale chez eux est largement imprégné du discours soviétique. Et surtout du discours aussi qui tend à montrer que les Russes sont le principal peuple à avoir, on va dire, favorisé… contribué, pardon, à la victoire. Et aujourd’hui, les Ukrainiens mettent en avant — dans cette exposition, il y a une mise en avant — la participation du peuple ukrainien. Elle est aussi prise au sens large. Les Ukrainiens ont été victimes de plusieurs manières, et cela rappelle également, bien évidemment, la population juive ukrainienne et l’Holocauste en Ukraine. Donc, on a comme ça une transformation du récit historique en temps de guerre, et c’est ce que j’appelle la mémorialisation en temps de guerre.
Par l’effet de mémoire, en étant plongé dans une guerre, on pense à une autre guerre: la Seconde Guerre mondiale. Il est vrai que le nombre de victimes ukrainiennes dans l’Armée rouge était colossal. Évidemment, il y avait aussi le mouvement nationaliste, etc., durant la guerre, qui a collaboré avec les Allemands. Donc il y a une histoire multiple, et parfois violente. Mais la monopolisation, imposée par la Russie sur la victoire de la Seconde Guerre mondiale, crée ce narratif de la victoire monopolisée par l’Union soviétique, et ensuite par la Russie, en tant que pays «victorieux». Et ce culte de la victoire en Russie sert aussi à justifier d’autres agressions russes, notamment contre l’Ukraine. Dans le discours de Vladimir Poutine lors de la grande invasion de février 2022, il disait vouloir «dénazifier» l’Ukraine. Comment cette mémorialisation se transforme-t-elle aujourd’hui, sur le terrain, quand on voyage, comme tu le fais, en Ukraine ?
Alors, c’est justement ce deuxième phénomène que j’appelle la mémorialisation de la guerre, c’est-à-dire ce qui touche à la guerre et principalement — on va dire — aux victimes de guerre. Pas uniquement, mais cela concerne aujourd’hui une large partie de la mémorialisation, car c’est là que l’on prend vraiment conscience de ce que fait la guerre. On s’en rend compte en visitant des villes où l’on voit des ruines, des bâtiments détruits, où l’on entend des bombardements. Et puis, ce que l’on constate aussi, ce sont les victimes de guerre.
Alors, il y a les victimes civiles — par exemple lorsqu’un bombardement a lieu, comme dans la nuit du 24 au 25 avril à Kyiv, dans le quartier de Sviatochyne, où je me suis rendue pour justement observer une mémorialisation immédiate ou spontanée. Tout à fait. On y trouve souvent des peluches déposées, des fleurs, des portraits, parfois quelques petits messages, et des personnes viennent s’y recueillir.
Et puis, il y a les victimes militaires. Hier encore, j’ai assisté aux funérailles d’un soldat au monastère Saint-Michel. Ce que l’on constate, c’est que la mémorialisation des victimes militaires est souvent plus visible, plus présente dans l’espace public que celle des victimes civiles. Ce n’est pas propre à l’Ukraine : lorsqu’on observe ce qui se fait en temps de guerre, voire même après les guerres, paradoxalement, les victimes militaires prennent une place importante, car elles sont vues comme étant au premier rang de la défense du pays.
Et donc là, plusieurs phénomènes se manifestent: on trouve les fameuses “allées des héros” dans les villes, dans les quartiers des grandes villes, par exemple à Kyiv. Il y a le mur du souvenir sur l’enceinte du monastère Saint-Michel. Il y a aussi ce champ de drapeaux sur Maïdan. Mais dans les différents districts de Kyiv, on retrouve également des panneaux commémoratifs : ce sont souvent des portraits accompagnés de biographies, fixés sur des supports métalliques. On observe cela partout en Ukraine : je l’ai vu à l’Est, à Mykolaïv, à Odesa… Ce sont ce qu’on appelle les allées des héros, ou allées de la gloire. Ce sont des mémoriaux en plein centre-ville.
Ensuite, dans les cimetières, on trouve ce qu’on appelle aussi des allées des héros — en fait, ce sont des carrés militaires dans des cimetières civils. C’est pourquoi, à Kyiv notamment, il y a ce projet de cimetière militaire national, qui pourrait rendre hommage à l’ensemble des victimes militaires, et pas seulement à celles tombées dans la guerre actuelle contre la Russie, mais aussi à celles des conflits précédents entre l’Ukraine et la Russie.
Et ce qu’on observe également, et qui est particulièrement nouveau, c’est la mémorialisation en ligne. Aujourd’hui, plusieurs initiatives existent.
Il y a aussi la mémoire des victimes civiles et celle des victimes militaires, avec une présentation un peu différente. Il y a également toute une mémorialisation en ligne, effectuée par les familles elles-mêmes.
Et ce qui m’intéresse aujourd’hui, en effet, c’est que je mène des entretiens avec des familles de soldats tombés au combat, pour comprendre la manière dont ces familles perpétuent le souvenir de leurs enfants, de leurs maris, de leurs frères. Je m’intéresse aussi à la place du deuil dans la société, et à la façon dont il reconfigure les rapports sociaux. En discutant avec des mères ou des épouses de soldats, on se rend compte que leurs réseaux sociaux ont souvent été transformés : elles se sont rapprochées d’autres femmes — mères ou épouses de soldats morts —, c’est-à-dire de personnes qui vivent en quelque sorte la même tragédie.
Oui, cela a créé des communautés, des communautés très soudées, car elles partagent cette expérience intime de la perte d’un proche — souvent un enfant, un mari ou un ami. Ce sont des communautés tout à fait particulières, car c’est une expérience difficile à exprimer à l’oral ou à partager dans un dialogue abstrait. C’est une expérience vécue, profonde, qui unit ces femmes. Il y a aussi des hommes bien sûr — des pères — et il ne faut pas oublier les femmes militaires qui sont également tombées au combat.
Évidemment, ce sont en majorité des hommes qui composent l’armée, mais il ne faut pas oublier qu’il y a 50 000 femmes ukrainiennes engagées dans les forces armées. Elles sont aussi parfois victimes, souvent dans des rôles comme médecins, infirmières, etc. Cela crée une expérience difficile à communiquer, mais qui donne naissance à des réseaux de compréhension profonde. C’est très intéressant.
J’imagine que ce n’est pas facile d’entrer dans ces réseaux, ce sont des cercles assez fermés. Est-ce que tu pourrais décrire les difficultés que tu rencontres, les obstacles à surmonter pour accéder à ces communautés ?
C’est vrai que ce n’est pas facile, mais les cimetières sont devenus des lieux de sociabilité importants. Il y a des familles qui s’y rendent parfois tous les jours, parfois toutes les semaines. Et en réalité, ce sont presque des rendez-vous informels. J’ai pu observer — cela dépend des villes, bien sûr — que, par exemple, le samedi matin, beaucoup de gens se rendent au cimetière. Et là, on se retrouve, on discute. Je peux donc observer ces échanges directement en me rendant dans les cimetières.
En revanche, ce à quoi je n’ai pas encore vraiment accès, ce sont les discussions en ligne, sur les groupes des réseaux sociaux, ou dans des groupes WhatsApp qui se sont formés. Ces familles se sont souvent solidarisées, parfois même autour de luttes communes — pour rénover un carré militaire, ou simplement pour en construire un.
Ce sont des réseaux très intéressants, parce qu’ils sont en interaction avec les pouvoirs publics. C’est ce que j’ai pu observer, par exemple, à Odesa. Pour l’instant, il n’y a pas de carré militaire officiel, et il y a donc un dialogue assez compliqué entre les autorités locales et les familles, concernant le type de carré militaire à créer.
Il faut savoir que, jusqu’à présent, le granite noir domine dans les cimetières militaires — un choix lié aux entreprises locales, à l’économie du pays, à des pratiques installées. Mais certaines familles souhaitent des matériaux plus clairs, comme le calcaire blanc, la terranopil par exemple.
Donc ces communautés de deuil, formées par les familles, permettent d’aborder toute une série de sujets qui ne relèvent pas uniquement du deuil, mais qui touchent aussi à la mémoire collective, à l’esthétique, à l’économie, et aux rapports entre citoyens et institutions.
Là où c’est, je pense, plus compliqué, c’est toute une réflexion à avoir — j’allais dire même entre chercheurs, et nous l’entamons notamment avec certains collègues en France aujourd’hui — c’est la question de la distance du chercheur par rapport aux enquêtés. Ce type d’observation génère beaucoup d’émotions, à la fois chez les enquêtés, puisque souvent je suis face à des femmes, des pères aussi, qui sont dans l’émotion, qui racontent des histoires, et bien évidemment, il faut pouvoir gérer cette émotion.
Le chercheur est parfois, j’allais dire, presque impliqué. On me pose des questions sur quel carré militaire serait mieux dans telle ville, puisque je suis considérée comme une experte, donc on me demande mon avis, mes conseils.
Et puis, pour ces familles, s’intéresser au sort de ce qui est arrivé à leurs enfants, elles le prennent aussi comme un soutien. Par exemple, j’ai une maman qui m’a dit : « La prochaine fois que vous venez à Kyiv, venez dormir chez moi » — cette grande ouverture, cet accueil. Donc voilà, c’est très compliqué parce que c’est un sujet particulier, mais c’est un sujet vraiment, j’allais dire, très important, quand on voit la place qu’il occupe dans la société, aussi dans l’espace public. Et quand on revient, on essaie de relier cette expérience très traumatique… Ce n’est pas un secret, la société ukrainienne est largement traumatisée par cette expérience de guerre.
Les communautés dont tu parles, les communautés des gens qui ont perdu des proches dans cette guerre, ce sont des communautés extrêmement traumatisées. Et quand on revient à la question du nationalisme chaud, qu’est-ce qui est en train de se forger dans cette souffrance citoyenne ? J’imagine que les expériences sont très différentes et que les conclusions peuvent être très plurielles chez les familles, etc. As-tu l’impression qu’il y a quelque chose que les familles essaient de mettre en avant pour s’assurer que cette immense tragédie, la mort, le décès de quelqu’un de proche, qui ne s’est pas produit en vain, est-ce que ça renforce justement ce “nationalisme chaud” dont tu parles?
Oui, je pense que le deuil fait aujourd’hui partie de cette mémorialisation chaude et de ce nationalisme chaud qui s’entretiennent mutuellement. Il y a cette idée dans la mémoire, dans le fait de raconter l’histoire des soldats morts au combat.
Si je prends par exemple la manière dont les mères m’ont raconté, j’ai peut-être un peu plus discuté aujourd’hui avec des mères qu’avec des femmes. Souvent, elles expliquent — il y a toute cette question de la culpabilité qui est complexe — comment elles n’ont pas pu retenir leur enfant. Maintenant qu’ils sont morts, vous voyez, il y a cette idée qu’elles n’ont peut-être pas pu le retenir, mais que de toute façon c’était son choix. Il avait pris sa décision, il était majeur, que pouvaient-elles faire ? Et il y a une sorte d’accompagnement. Peut-être aujourd’hui ce que je peux remarquer, c’est une espèce de… Alors bien évidemment, ça dépend du moment. Aujourd’hui, quand un proche décède, il faut un certain temps — je pense un an ou deux ans. Voilà, j’ai rencontré une mère de soldat à Odesa qui me disait que son fils est décédé il y a un an et demi, et qui me disait qu’il y a six mois elle n’aurait pas pu discuter avec moi.
Donc voilà, il y a cette question du temps qui amène une certaine réflexion. Ce que je constate, c’est que chez certaines mères de soldats, il y a le prolongement de l’engagement de l’enfant, c’est-à-dire la création aussi de ces communautés de mères de soldats, souvent parfois de la même brigade, des relations avec les frères d’armes qui continuent, le soutien donc à la brigade, le soutien financier, le soutien moral. Donc il y a à la fois la mémoire et puis l’engagement en quelque sorte de ces familles, qui s’étaient peut-être aussi parfois tenues en retrait parce que le fils ne disait pas grand-chose sur ce qu’il faisait — ça pouvait arriver, il ne transmettait pas son expérience — et ensuite ces mères, je pense à celle que j’ai rencontrée à Odesa, qui découvre tout ce qu’il a fait, ce que racontent les frères d’armes, et qui se sent finalement engagée dans le même processus et qui prolonge en quelque sorte le combat d’une autre manière.
D’aider, par exemple, son unité, par des collectes de fonds et par tout cela. Donc ces fonds partent de cette communauté déjà militaire, des survivants, pour l’instant ce sont les camarades, comme les mamans qui formaient avant les conseils d’école, les mamans qui étaient avec leurs enfants pendant la classe. Après, ça forme des communautés de femmes qui ont perdu leurs enfants et qui s’intéressent tout de même à cette cause-là, et qui renforcent le sens de cette lutte que leurs enfants menaient.
J’ai eu une maman aussi, là à Kyiv, qui me disait — quand je lui demandais si elle avait des contacts avec les frères d’armes — elle me dit oui, oui. Et elle me disait, c’était très émouvant: «Pourvu qu’ils restent en vie, parce qu’il ne me reste qu’eux».
C’est-à-dire qu’on voit comment elle continue à accompagner le souvenir de son fils, à travers ce que racontent, à travers le rapport avec ses frères d’armes, avec lesquels son fils a passé autant de temps, notamment ses derniers instants.
Tu as fait plusieurs voyages, et cette fois-ci de manière tout à fait particulière: tu as visité le Sud, c’est-à-dire Kherson, Mykolaïv, Odesa. Est-ce que tu constates qu’il y a des différences régionales dans cette culture de mémoire, dans cette mémorialisation, dans les différentes régions ukrainiennes ? Ou au contraire, peut-on affirmer que la culture de la mémorialisation des victimes militaires et civiles est un facteur unificateur de l’Ukraine d’aujourd’hui ?
Je crois que la guerre russo-ukrainienne implique des problématiques communes, quelle que soit la région. Et notamment à travers la mémorialisation. Ces allées dans les centres-villes, ça génère de toute façon des discussions entre les autorités et les populations locales sur le format, sur l’entretien. Les pouvoirs publics doivent donner leur accord, même quand ce sont les familles qui réalisent certains monuments, pour l’utilisation de l’espace public.
Ce que je trouve intéressant aujourd’hui à observer, c’est ce que j’appelle cette co-construction de la mémoire entre les autorités et les citoyens, avec une demande mémorielle des citoyens extrêmement forte. Beaucoup de choses sont faites par eux, demandées par eux, et ce ne sont plus uniquement les pouvoirs publics qui imposent la mémorialisation de la guerre. C’est un phénomène très intéressant.
On l’observe, et il varie selon les municipalités, plus qu’en fonction des régions. En effet, ce sont les municipalités qui sont en charge de cette mémorialisation de la guerre. Cela dépend donc aussi du courant politique de la mairie, des relations avec les familles, de la conception même de l’histoire du pays, qui est variable d’une municipalité à une autre. Mais ce n’est pas un phénomène différent d’autres pays.
Aujourd’hui, il y a quelque chose de plus consensuel en Ukraine, même s’il ne faut absolument pas nier que l’expérience de la guerre est différente selon les régions. Cette expérience est différente, bien sûr, puisque Kherson, Mykolaïv, ou le Donbas sont en partie occupés. Il y a des régions qui ont vécu l’occupation, d’autres non. Mais il y a aussi en Ukraine des personnes très éloignées du front, mais qui sont néanmoins très impliquées, soit dans l’aide humanitaire, soit parce que leurs proches sont sur le front.
Les différences viennent aujourd’hui davantage non pas des régions elles-mêmes, mais de la manière dont on vit la guerre, selon son propre engagement, ce qu’on y fait, et ce que vivent les proches. Et donc, dans toutes les villes où je suis allée, il y a toujours des personnes engagées dans ce que j’appelais tout à l’heure la découverte de la culture ukrainienne — une culture aussi bien nationale — avec des personnes aujourd’hui considérées comme des dissidents, comme Vasyl Stous. Beaucoup de villes vont d’ailleurs dédier des noms.
Il s’agit de la redécouverte de la culture ukrainienne, mais aussi la redécouverte du patrimoine local, de la culture locale. J’aimerais citer une collègue et experte des questions mémorielles Oksana Dovgopolova qui appelle Odessa “une ville non impériale dans un projet impérial”. Aujourd’hui, elle milite pour la création d’un musée qui montrerait cela: comment, à Odessa, on a résisté à l’impérialisme russe.
Il y a également des échos entre cette réflexion sur l’histoire et la mémorialisation de la guerre. Il existe une idée aujourd’hui à Odesa d’avoir dans un des cimetières un carré militaire avec une chapelle multiconfessionnelle.
Le projet qui est en train d’être discuté aujourd’hui avec les acteurs religieux, les familles, les acteurs politiques. En conclusion, la guerre russo-ukrainienne, nationalise, tout en essayant de maintenir la relation et le dialogue — ce qui réunit et ce qui différencie. Parce que, de toute façon, chaque ville, chaque village a aussi sa propre culture. Cela prend un visage local.
La culture de la mémoire est une continuation de la vie humaine, elle est donc différente dans plusieurs régions, dans des régions différentes. La mémoire peut aussi avoir des couleurs différentes, selon cette spécificité régionale.