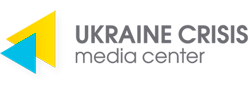Comment l’Ukraine d’aujourd’hui est vue par une poète québécoise? Quelle image poétique correspond le mieux au pays épuisé mais résistant? Dans ce podcast nous rencontrons Hélène Lépine, autrice québécoise, membre du PEN Québec, titulaire du prix René-Leynaud, remis à Lyon en 2022 pour son ouvrage poétique “Le Cœur en joue”. Hélène a parcouru une grande partie du globe: étudié en Bulgarie, travaillé à Moscou, vécu en République dominicaine et dans les Caraïbes. Elle a notamment visité la Syrie en 2008. En 2025 elle s’est rendue en Ukraine pour découvrir le pays en guerre.
Bonjour Hélène, vous êtes poète, membre de PEN Québec, vous avez reçu le prix René-Leynaud et aujourd’hui vous êtes ici en Ukraine. Pourquoi ce voyage et qu’est-ce qui vous a inspirée à traverser la moitié du globe pour arriver à la gare de Kyiv?
Je pourrais vous dire d’emblée que bien sûr j’ai eu un intérêt très très jeune pour tout ce qui était la partie slave du monde et mon passage à Kyiv alors que j’étudiais le russe a été marquant dans une certaine mesure. Mais c’est véritablement beaucoup plus la situation actuelle qui m’a guidée dans ce choix de venir. Cette nécessité, en quelque sorte, d’être parmi vous, avec vous, par solidarité et aussi par admiration pour cet esprit de résistance qui est quand même un peu hors du commun. Et puis récemment, enfin, je dirais, récemment, l’attention est un peu dirigée vers notre voisin du Sud, un petit peu plus éloigné, le regard est un peu plus détourné de l’Ukraine qu’il ne l’était auparavant. Et puis les amitiés aussi, les amitiés tant poétiques que locales avec des Ukrainiens, des Ukrainiennes. Il faut dire que j’étais attirée par ces gens déjà d’emblée par la secousse terrible à laquelle ils font face et continuent de faire face. Alors tout ça m’a menée àaccepter avec enthousiasme l’idée du projet, même si dans ma vie c’était peut-être un moment particulier.
Nous sommes au centre de Kyiv. Nous sommes à quelques centaines de mètres du Maïdan, la place clé de l’Ukraine. Vous êtes titulaire du prix René-Leynaud, remis à Lyon en 2022. C’était pour votre ouvrage poétique “Le Cœur en joue”, n’est-ce pas?
C’est un prix intéressant dans le sens où il va exactement dans le sens de mes préoccupations. C’est un prix qui est accordé à un ouvrage, comme le disent les organisateurs, un ouvrage nécessaire aux jours blessés d’aujourd’hui.
Alors, je dois dire que, justement, pour ce qui est de la Syrie, où j’avais voyagé avant 2011, j’ai fait des amitiés avec des femmes, des jeunes étudiantes. La terrible répression qu’il y a eue dans ce pays, et puis ce qui a duré, dure encore, en fait, dure, et a été un peu rétabli, mais rien n’est tout à fait résolu.
Parler justement d’une blessure importante, c’est quelque chose qui m’a toujours préoccupée dans la vie. Les blessures tant sur le plan personnel des individus que des sociétés et tout, le moment où il y a une fracture,dans une vie et comment, inévitablement, forcément, la vie nous demande de renouer avec elle, d’aller vers l’avant et de, en quelque sorte, tracer un chemin, comme le dit le poète Machado. Camino se hace al andar. Al andar se hace camino. Et on ne peut pas revenir en arrière. On trace le chemin pas à pas.
Alors, en quelque sorte, c’est un petit peu à la fois cette impuissance, quand je dis le cœur en joue, le cœur est donc tenu en joue devant la terrible réalité, mais en même temps, il y a cette nécessité d’aller au-delà de l’impuissance.
Et pour moi ça passe par les mots, ça passe par le désir de m’approcher, de regarder, non pas de comprendre d’une façon nécessairement très précise ou analytique, mais de saisir un peu où sont les blessures, les fissures, les fractures,mais aussi ce qui va germer, un peu de potentiel de vie, de retour vers la beauté, vers la liberté. Je sais qu’il y a un aspect un peu naïf à tout ça, mais je crois que la vie est plus forte que la mort. Et puis ici, on sent très, très bien cet appel du mouvement de la vie, cette force. C’est une des impressions majeures de ce voyage.
Vous êtes bien ici à Kyiv, en Ukraine, et durant les temps aussi difficiles où les fractures et les ruptures sont tellement multiples parce qu’on est en pleine guerre. Mais c’est aussi une terre de poètes, on dit souvent qu’on n’a jamais vu une telle renaissance poétique ou une telle importance accordée à la poésie que pendant justement ce temps véritablement tragique où il y a la mort, où il y a des blessures, où il y a le danger. Vous avez pu constater vous-même en dormant quelques minutes à Kyiv que le danger est tout à fait physique, qu’il est tout à fait réel et qu’il peut toucher tout un chacun.
Quelles sont vos premières impressions de la scène poétique, des rencontres que vous avez faites pendant ces jours actifs, qui vous ont renforcée peut-être dans votre conviction que la poésie est là où il y a justement cette tragédie, cette rupture.
Elle est présente encore plus quand on a besoin d’elle. Oui, et je vous dirais, si vous me permettez, c’est la poésie aussi. J’ai peut-être oublié de mentionner cet aspect absolument essentiel dans les motivations qui ont fait que je suis ici. La poésie m’était déjà parvenue grâce à des ouvrages.
Alors, en particulier des ouvrages dont la traduction a été assurée par Ella Yevtushenko. Alors, il y a cette anthologie formidable qui a été faite avec Bruno Doucet en France et qui me permettait de découvrir, parce que mon ignorance était quand même grande, outre les grands noms, et de découvrir, en partant de la poésie actuelle des jeunes, et en remontant vers la poésie antérieure, de découvrir une poésie très vivante, mais d’autant plus vivante aujourd’hui que le mode d’expression est un mode d’expression marqué par cette double vie, la vie bousculée par la guerre, la vie qui s’introduit dans l’appartement, dans la maison, dans tout, et qui est à la fois, comment dire, une vie menacée et une vie qui est aussi… qui est comme nourrie. Alors, il y avait cette poésie-là, et particulièrement au Québec, on a eu aussi la poésie venue, encore une fois, grâce à Ella Yevtushenko, qui a été invitée par une poète de chez nous à faire une revue qui portait seulement sur l’Ukraine. Et encore là, on a découvert d’autres noms, d’autres poètes. C’est très, très vivant. Et les poètes québécoises ont répondu, en quelque sorte, dans le même ouvrage. Alors, la poésie est peut-être le mode d’expression qui a le plus résonné à mes oreilles et résonne encore ici.
J’ai eu le plaisir de rencontrer deux personnes, deux artistes, donc cette poète, Ella Yevtushenko, dont la poésie est marquée par la concrétisation, des choses très, très concrètes et qui parlent de l’urgence de vivre.
Et par une artiste, Olesya Drashkaba, chez toutes les deux, il y a cette charge poétique qui dit « Allez ».Rien n’est simple, mais poursuivons. Et poursuivons en ne ménageant pas non plus la vérité. On dit, on fait, il y a des images très très fortes, mais en même temps, on propose. On propose des images, des images avec une certaine acuité du regard et une acuité des sens. Les perceptions sont accrues.
Je trouve ça particulièrement intéressant. Les perceptions sont accrues, ce qui est peut-être, pour mon œil, invisible devient visible grâce à la poésie, grâce à l’art de cette artiste. Et puis c’est quelque chose qui a éveillé mon regard en étant ici, bien que d’emblée, j’aie été très frappée par la superposition de deux réalités. Un peu comme la belle ville de Kyiv avec ses collines, le haut et le bas, et il y a une espèce de survie, pas la survie, la survie où autre chose se perçoit, se sent. Et grâce à cette attention accrue et que je ressens chez les gens et qui m’a portée à être beaucoup plus attentive aussi, il y a aussi cette image qui me frappe, il y a la ville fleurie.
La ville fleurit avec le printemps. Et puis, il y a la ville en alerte. Et c’est comme le haut et le bas. La ville fleurit, c’est ce que l’on voit. Et la ville en alerte, c’est l’abri où l’on doit descendre la nuit, c’est la ville aux aguets, c’est la crainte, c’est l’angoisse.
Et ce n’est pas tellement mon angoisse, parce que je me sens tout à fait privilégiée dans le sens où pour moi, dans le temps, c’est très limité. Par contre, je sens très, très bien que pour ces gens que j’ai rencontrés, c’est quelque chose qui est présent, mais que l’esprit pensant essaie de surmonter.
C’est une, probablement, cette angoisse nourrit toutes les sensations, les perceptions, mais aussi le désir, le désir de surmonter. Et je trouve que tout le monde vit un peu, à la fois, pas tout le monde, comment dire, les personnes avec qui j’ai parlé, vivent beaucoup, beaucoup de l’esprit. L’esprit, on pense, on note, on réfléchit. Mais aussi, on sent très, très bien quand l’urgence du désir, quand il est temps d’admirer quelque chose, de prendre un verre de vin, de décider de rire. On le fait à plein. Il n’y a pas de mesure. On fait les choses à fond. Et c’est très frappant.
Comme on dit souvent, les nuits ici font survie et après durant les jours on vit. Il faut aussi préciser que nous nous retrouvons dans une saison tout à fait splendide parce que nous sommes au printemps, au début de l’été.
Cela me fait penser à une autre ligne d’une autre poète ukrainienne, Yaryna Tchornohouz, qui d’ailleurs aujourd’hui est traduite par Ella Yevtushenko et dont le livre va sortir en France à l’automne 2025 aux éditions Tripode. Et donc il y a cette ligne qui est tout à fait marquante et qui résume en fait la situation. Elle dit, “l’Ukraine c’est un pays où on n’oublie pas les hivers”.
Plusieurs événements majeurs, les révolutions par exemple, la dernière, Euromaïdan, c’est l’hiver, c’est novembre 2013 jusqu’à février 2014. La grande invasion russe, c’est février 2022, donc l’hiver qui est éprouvant, qui est long comme au Canada, comme au Québec aussi, pareil, avec des températures très basses, avec des épreuves physiques très importantes.
Mais après cette période hivernale, vient toute cette beauté que vous constatez, toutes ces fleurs, à commencer par les marronniers qui ne sont plus là, sur la rue Khreshchatyk, mais qui étaient là il y a quelques semaines seulement, avec ces arbres splendides.
Je reviens à votre expérience syrienne, parce que dans votre livre, vos textes poétiques sont intercalés, mêlés avec les illustrations de Dima Karout, qui est canadienne d’origine syrienne.
On compare souvent, en fait, la guerre en Syrie avec la guerre en Ukraine, parce que l’agresseur est le même, parce que derrière le régime de Bachar el-Assad, nous retrouvons souvent la Russie, et donc les méthodes employées, comme par exemple les bombardements, et on a beaucoup comparé Alep par exemple, avec Marioupol, une ville où on n’a plus accès parce que c’est en occupation russe.
Quels échos syriens vous reviennent quand vous êtes ici en Ukraine ? Est-ce que vous voyez les similitudes ou bien en même temps vous voyez aussi les divergences dans le traitement de la situation, dans le traitement politique de la situation ?
Je vais le dire avec une certaine réserve parce que mes contacts sont plus limités maintenant. Mais je pense que d’emblée, ce qui frappe, c’est toute la question du non-respect de la vie civile. Bien sûr, il y a eu la Tchétchénie, il y a eu d’autres choses avant, mais là, c’était le non-respect de cette vie civile, le non-respect de ce qui a été un trésor d’humanité aussi, parce qu’Alep, c’était une ville aussi de la diversité, de l’échange. Alors il y a quelque chose où il me semble qu’il y a ce non-respect qui est terrible et puis qui semble s’établir comme un mode guerrier, sans éthique.
Une guerre totale, comme on appelle ça. Une guerre totale qui ne respecte rien.
Par contre, dans ce que j’ai pu à la fois lire ou discuter avec les gens que j’ai connus, il y a cette même – le mot me semble trop faible – résilience. Il y a ce même courage, disons. Ce même courage pour dire, bon, ça y est.
Ça y est, on se relève, on poursuit. Il y a une nécessité aussi de se ressaisir parce qu’il y a les enfants aussi. Alors dans les deux cas, j’entends beaucoup parler aussi des enfants. J’entends parler du fait qu’on met de côté, on se met un peu de côté pour la famille, aider à nourrir une vision d’avenir, même si elle chancelle parfois dans l’esprit des gens qui soutiennent les enfants. Mais ce qui me frappe toujours, c’est l’espèce de cohérence, de cohésion du groupe quand on décide, bon, ça y est là, on agit, on œuvre.
Et puis, nos efforts vont dans le sens d’une remise en marche sur un sentier méconnu, inconnu. Des fois, c’est le déplacement. Des fois, c’est demeurer sur place.
Et dans le cas de Dima Karout, c’est un déplacement, c’est la volonté de faire en sorte que l’art parle, parle à tous, non seulement aux Syriens, mais aussi à ceux qui ne connaissent rien de tout cela. Et maintenant, on est toujours en contact. Je viens de lui parler en venant vers l’Ukraine.
Et à Londres, elle entretient elle-même cette espèce de conversation tant avec le public britannique qu’avec les déplacés des pays du monde arabe ou du monde africain où il y a un problème. Elle entretient ce qu’elle appelle cette conversation sur la nécessité non pas de rester accrochée aux images de destruction, mais d’essayer de progresser, de fournir à ceux qui sont de génération plus jeune, mais qui souffrent et qui n’ont pas la même fondement solide dans leur petite vie, de leur fournir, justement, quelque chose qui est presque une maison, bâtir maison sans maison.
Je sens ce désir de bâtir maison, même si la maison s’est écroulée. Bien sûr, avec tout ce que ça suppose de tristesse, de drame. Puis là-dessus, je voudrais bien spécifier que j’en parle avec un peu de gêne, parce que ce n’est pas moi qui souffre. D’ailleurs, je pense que vraiment, ça doit être clair pour toute personne qui nous écoute. Moi, je me sens privilégiée, je n’ai pas eu à vivre une telle vie. Alors, je n’ai pas à vivre dans ces circonstances, mais je ne peux faire autrement que de ressentir des choses.
De rendre compréhensible aux autres et faire les autres sentir ce que vous sentez en tant que poète et le mettre en mots.Pour que les autres comprennent, j’aime beaucoup votre expression de la “maison sans maison”, parce qu’on dit souvent, on essaie d’expliquer que les bombardements de la population civile qui font perdre leur maison, ce n’est pas uniquement les biens matériels, il ne s’agit pas de perdre des murs ou bien perdre un toit, ça veut dire perdre tout un monde, parce que ce sont là des toits ou des murs où il y avait toute une petite vie, tout un petit univers avec une famille, c’est l’endroit où les enfants ont grandi, c’est là où il y a ta bibliothèque ou tes livres favoris, c’est là où il y a quelque chose qui te rappelle ton passé. Donc ce sont une multitude, une centaine de milliers de maisons qui sont détruites, qui restent dans les esprits. On parle souvent avec les déplacés, des gens dont la maison est en occupation, par exemple.
Elle est détruite et puis ces gens portent cette maison avec eux toute leur vie, même si cette maison n’est plus ni physiquement, elle n’est que dans leur mémoire, mais cette maison, d’une manière ou d’une autre, elle ne disparaît pas. Et dans votre voix, dans votre engagement, il y a cette dimension féminine, de l’engagement féminin, qui est important, parce que vous avez fondé, à l’intérieur de PEN Québec, un Comité Femmes. C’est quoi, cette solidarité entre femmes ?
C’est justement, probablement cette espèce de position où, en quelque sorte, on est obligée d’être dans le regard et non pas dans l’action, mais il y a quand même ce besoin de partager et de faire entendre, justement, les voix des personnes qui sont privées de haut-parleurs, mais pire encore, privées même du droit de parole.
Privées du droit de faire entendre la poésie ou la traduction, que ce soit des femmes journalistes, des femmes traductrices, des poètes, des essayistes. Alors, dans notre esprit, c’était bon. Allez, nous, on a la possibilité de faire des jumelages avec des personnes dont la voix est complètement inaudible et demeure éteinte pour des circonstances de répression. Alors, prenons les textes, lisons les textes. Il y a tout le moins, si on ne possédait pas les textes au début, c’était un peu plus compliqué. Mais là, on a trouvé de plus en plus de voix pour y parvenir, de canaux. Mais l’idée était de faire entendre, donc de lire, ou d’écrire à ces personnes. Alors il y a toute cette question de l’adresse à la personne à qui on peut être facilement jumelée par intérêt par désir particulier de faire entendre cette voix-là, sans qu’il y ait nécessairement de parenté d’intérêt. Mais c’est véritablement comme ça que les choses se sont produites. On a fait des spectacles avec de la musique. Il y a eu énormément d’activités et ça se poursuit. Ça se poursuit à plus ou moins grande échelle selon les années. Maintenant, moi, je suis moins active de ce côté-là pour, justement, nos centres d’intérêt se déplacent ou on laisse la place à d’autres parce qu’il y a toujours ces bons mouvements de la relève.
Mais c’est très important, ça continue d’être très vivant, et au PEN Québec, il y a ce désir de faire connaître, ce désir de laisser la voix libre pour que les œuvres parviennent à leur lectorat.
Pour vous comme poète, pour chaque poète, en fait, ce qui compte beaucoup, c’est le rapport intime à une réalité. Et donc, on peut facilement imaginer que vous aviez une idée de ce que vous alliez voir en Ukraine. Là, vous arrivez à la fin de votre voyage. Il n’est pas encore terminé. Vous restez encore en Ukraine quelques jours, mais vous avez déjà pu voir des choses.
Qu’est-ce qui vous a surpris ? C’est-à-dire, qu’est-ce qui a trahi vos idées, en fait, de ce que vous alliez voir ? Est-ce que vous étiez surprise par quelque chose ? Et qu’est-ce qui vous a marquée?
Vous savez, je crois que je découvre une diversité. Il y a une diversité linguistique. Il y a une diversité de mentalités. Et parmi les gens qui me parlent, malgré cette cohérence et cette cohésion qui les fait agir, œuvrer comme dans une certaine mission de remise en route, il y a quand même cette qualité des voix qui est différente où on entend la diversité, la diversité de provenance, la diversité aussi de l’identité, l’identification à l’Ukraine est différente. Alors, c’est cette diversité-là qui est peut-être ce qui m’a surprise davantage parce que dans ma tête, à moi, tout le monde était dans une forme, une certaine unité.
Je ne dis pas qu’elle n’est pas là, non. C’est pour ça que je ne voudrais pas m’aventurer sur un plan qui n’est pas, comment dire, de l’ordre poétique. J’en parlerai dans la mesure où je serais capable de fournir des images où je vois autant de fleurs et d’arbres et de variétés de tout cela, mais qui forment un paysage unique.
Alors ça, c’est peut-être cette diversité-là qui va rester, même en image, mais qui n’empêche pas la force de l’unité. Donc un pays qui est très varié, qui est très diversifié, évidemment.
Et encore, vous êtes ici au moment de l’unité sans précédent. On peut imaginer combien le pays est différent quand il n’y avait pas ce défi existentiel devant tout un pays, tout un peuple, toutes les voix et donc combien on était très différents avant cela et on le sera peut-être après. C’est cette diversité-là qui est aussi synonyme de ce qu’on appelle le monde libre.
Oui, c’est ce que j’allais dire. Il y a quelque chose de très positif dans ça. Parce que la création, toute cette diversité-là est dans un moment aussi de création, d’un présent, de la suite des choses. Alors, il y a un potentiel très fort dans cette diversité-là. Et ce n’est pas un rêve unique, mais c’est un rêve coloré de différentes nuances. Avec des couleurs différentes.
La dernière question, est-ce qu’on peut attendre un autre recueil poétique ou quelques poésies suite à ce voyage en Ukraine?
Écoutez, je pense que ce serait mon vœu le plus cher que, oui, que naissent des poèmes de tout cela. Pour le moment, je suis submergée par les impressions et j’imagine que la poésie, de toute façon, elle doit se déposer avant de surgir en mots et en images.
On ne commande pas ces choses, mais je vais m’asseoir pour laisser venir, laisser venir. Et puis, il y a une autre chose que j’ajouterais aussi, tout simplement en revenant au prix René Leynaud, si vous me permettez. Nous sommes le 13 juin aujourd’hui.
Et René Leynaud a été assassiné à l’âge de 34 ans, le 13 juin 1944. Alors, il y a quelque chose où, pour moi, déjà, ça fait image. Et puis je me disais, non,, il y a tout cet aspect-là d’une jeunesse fauchée. Et déjà, c’est une autre image. Puis je me dis, tout ça s’ajoute et ce ne sont pas des vers qui s’alignent, des lignes qui se suivent, un discours qui prend forme, mais ce sont certainement des images, et je pense à des jeunes, à un jeune homme en particulier à qui j’ai parlé, à Bila Tserkva, justement, un jeune soldat du même âge. Et ça me frappe beaucoup. Ces images-là vont rester. J’espère beaucoup pouvoir livrer quelques poèmes à la suite de mon séjour en Ukraine. Qui aurait l’Ukraine au cœur.