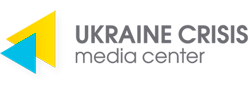«Le plus important à la guerre n’est pas le soldat, mais l’être humain»: une interview des réalisatrices du documentaire «Alisa in Warland»
Il y a encore deux ans Alisa Kovalenko et Luba Dourakova vivaient dans une chambre d’un foyer d’étudiants à Kiev, suivaient des études de réalisateur de documentaires et filmaient le Maidan.
Elles viennent de réaliser un documentaire «Alisa in Warland » sur la guerre dans le Donbass qui a été projeté lors du festival du cinéma documentaire à Amsterdam et du festival «Artdocfest» à Moscou.
Dans une interview exclusive pour l’UCMC, elles parlent des changements que ce film a apportés dans leur vie, de ce qui est le plus horrible dans cette guerre, du séjour d’Alisa dans une prison du DNR et de la réaction des spectateurs russes.
Que voulez-vous montrer dans ce film? Comment ce film a changé votre perception des événements dans le pays?
Alisa Kovalenko : J’ai l’impression que c’est un film sur l’acquisition de la maturité. Non seulement en ce qui me concerne moi, mais tout le monde : soldats, volontaires, nos amis du Maidan. C’est un film qui montre comment un individu fait un choix tout en comprenant le prix à payer et en assumant ses responsabilités. Au cours du tournage, dont la plus grande partie a eu lieu sur le front, il était important pour moi de comprendre mon rôle dans tous ces événements. Me poser la question : suis-je une réalisatrice avant tout? Ou une citoyenne? Il est difficile de garder une distance émotionnelle, car tu es trop impliquée dans tout ce qui se passe.
Les gens que je filmais sur le front, à Pesky, n’étaient pas pour la plupart des militaires professionnels. C’étaient des gars qui sont partis rejoindre les bataillons de volontaires, car ils ne faisaient pas confiance au gouvernement ukrainien. Ils sont venus sur le front pour défendre l’Ukraine. Dans le film, il y a un volontaire «Monakh», eh bien, tous les habitants de son village natal ont collecté de l’argent pour lui acheter un gilet pare-balles, tous les habitants sont venus lui dire au revoir, lui ont donné des provisions, des tomates, des concombres. Encore hier, certains combattants allaient à l’université, tout comme moi, certains avaient leurs entreprises, la plupart d’entre eux avaient fait des études supérieures. Quand tu restes longtemps avec eux et quand tu les filmes, tu commences à te poser des questions : «Qui suis-je?», «Dois-je faire aussi quelque chose?».
C’est la raison pour laquelle nous avons tourné un film personnel. Notre objectif n’était pas d’analyser les faits, mais plutôt de raconter nos sensations.
Lubov Dourakova : Quand nous faisions nos études à l’école du cinéma, nous discutions beaucoup sur ce qu’était la réalité. En février 2014 sur le Maïdan, j’ai réussi à filmer un cadre dans lequel Alisa apportait de l’huile pour les cocktails Molotov. Ce fut justement l’un des premiers moments où l’on a compris que l’on n’était simplement metteurs en scène, mais qu’on devait aussi faire quelque chose. Alors, nos collègues ont mis leurs caméras de côté pour faire du bortch, porter des pneus ou préparer des sandwiches. Finalement, pour moi, notre film est un film sur le désespoir d’une personne dont le pays se trouve en guerre.
Alisa, vous êtes une réalisatrice et aussi le personnage principal du film. Dans le film, il y a des cadres qui vous montrent tenir des armes et tirer. Pourquoi? Quelle est la différence entre le documentaire et le journalisme?
Alisa: Je pense que la différence principale est la distance. Pour un journaliste, il y a toujours une limite dans ce qu’il fait : la limite de l’objectivité et de l’impartialité au-delà de laquelle il ne peut pas aller. Comme je travaillais sur un documentaire, pour moi cette limite a cessé d’exister à un certain moment, car l’auteur de documentaires a le droit de fixer lui-même ses limites.
Durant le tournage, je voulais comprendre pour moi, jusqu’où je pouvais aller pour vivre cette vie dans la guerre, la ressentir totalement, la vie parmi ces gens-là, rester sur le front le plus longtemps possible. Quand tu oses faire cela, tu testes tes propres ressources, tes ressources de douleur et de réflexion. J’ai eu des moments quand psychologiquement, j’avais vraiment du mal à rester là-bas, mais j’arrivais à tenir.
Je suis restée sur le front aussi à cause de mes héros. Pour pouvoir filmer une personne dans la guerre, il faut que tu vives une partie de ta vie avec cette personne, il faut que tu traverses des moments difficiles à ses côtés. Le plus important à la guerre n’est pas le soldat, mais l’être humain. Parfois, tu restes longtemps à côté d’une personne sans que rien ne se passe. Et ensuite, tout d’un coup, quelqu’un rentre dans une pièce et parle de son enfant, et tu mets ce cadre dans le film.
Lubov : Le documentaire est toujours une histoire personnelle. Quand tu trouves le héros de ton film, tu restes à ses côtés. Tu ne peux pas réaliser ce genre de film en 2-3 jours. Contrairement au journalisme, le cinéma documentaire est un processus long. Parfois, le premier cadre est tourné plusieurs années avant la fin.
Dans votre film, il y a des fragments du Maïdan, filmé pour la plupart du temps par Lubov. Mais plus de séquences sont consacrées à la guerre filmée par Alisa. Quand avez-vous commencé à filmer la guerre?
Alisa : Je suis partie à l’est au printemps 2014. J’ai passé beaucoup de temps sur un point de passage entre Slovyansk et Kramatorsk. Pour moi, c’était la découverte d’un nouveau micro monde qui est apparu à ce point de passage. Il y avait des membres des «Berkut» qui avaient tiré sur les activistes du Maïdan, des soldats de la Garde Nationale. Il y avait les personnes de Lviv et de Luhansk. Plusieurs soldats ne comprenaient même pas pourquoi ils étaient là et ce qui se passait.
Un des soldats, tout le monde l’appelait «séparatiste», car il était originaire de Luhansk, recevait souvent les coups de fils de son père qui lui disait qu’il allait venir pour le fusiller.
Un autre soldat, qui était originaire de Donetsk, n’a pas pu tenir. À un moment donné, il est tout simplement parti, il est parti se ranger du côté des séparatistes. Avec des armes et avec tout son matériel.
Dans le film il y a un épisode dans lequel vous racontez comment vous avez été capturée et ce qui se passait en prison. Pouvez-vous en parler en détails s’il vous plaît?
Alisa: Jusqu’aujourd’hui, quand je vois cet épisode, je ferme les oreilles. En mai 2014, je rentrais en taxi du point de passage que j’avais filmé et au premier point de passage séparatiste, le chauffeur m’a trahi. À cette époque, beaucoup de chauffeurs de taxi collaboraient avec les séparatistes. Il a dit aux séparatistes : «elle fait partie de l’armée ukrainienne». On m’a arrêtée, on m’a fouillée pendant environ une heure. Ensuite, on m’a emmenée à la mairie de Kramatorsk. Durant tout le trajet, les femmes qui étaient là-bas voulaient me tabasser, mais l’homme qui était à côté leur disait qu’il ne fallait pas.
Le degré d’agression là-bas était tel que je ne savais pas comment me comporter. Ensuite, on m’a interrogée durant toute la nuit. Ils disaient qu’ils m’avaient vue en tenue militaire, que j’étais un pointeur ou un sniper ou les deux. Lors de l’interrogatoire, mon téléphone a sonné. En guise de sonnerie, j’avais la chanson : «Dès que nous allons combattre tous nos ennemis, on n’aura plus de chagrin». Alors, un militaire russe a attrapé mon portable et s’est mis à courir en criant : «Regardez qui nous avons attrapé, elle veut tous nous tuer».
J’avais du mal à comprendre la limite entre la vérité et les intimidations. Ils m’intimidaient comme ils pouvaient. Ils disaient qu’ils allaient me casser les doigts, c’était une procédure standard. Ils m’ont demandé d’appeler les soldats ukrainiens, de leur dire d’abandonner les positions, que cette guerre était inutile.
J’ai passé 4 jours en captivité. Mes gardiens portaient des Kalachnikov. Derrière moi se trouvaient deux gars qui échangeaient des blagues : « Vas-y, on va lui faire peur, elle se mettra à courir et nous lui tirerons dans les jambes? Ça sera drôle». Voilà leurs blagues.
Lubov : Alisa et moi, nous en avons beaucoup discuté. Elle a mis pas moins de 6 mois pour dépasser cette expérience. Finalement, elle a trouvé le courage d’ajouter dans le film cette scène, qu’on a du mal à raconter. Il vaut mieux regarder le film.
Le film contient aussi des cadres tournés à l’aéroport de Donetsk. Je sais que vous êtes la seule femme qui y était lors des moments les plus chauds. Comment cela s’est-il passé?
Alisa: J’ai passé deux jours à l’aéroport de Donetsk en octobre 2014. À cette époque, une partie du nouveau terminus était sous contrôle de l’Ukraine et l’autre sous le contrôle des séparatistes, les combats avaient lieu entre les étages. L’ancien terminus était contrôlé par l’armée ukrainienne et le Secteur Droit. Je suis arrivée au nouveau terminus et, la nuit on est passé dans l’ancien. On ne pouvait passer que la nuit, car on tirait à travers le territoire et il n’y avait nulle part où se cacher. J’avais peur, même en restant sur le char. Car si un obus atterrit sur un char, tout le monde meurt. Mais aller à l’aéroport fait encore plus peur que d’y être. La scène d’arrivée à l’aéroport figure dans le film.
Qu’est ce qui est le plus affreux à la guerre?
Alisa : La chose la plus affreuse c’est le froid. On finit par s’habituer aux tirs. J’étais sur la position «Ciel », une grande tour en fer, haute comme un bâtiment de dix étages à l’aéroport de Donetsk. J’y étais en décembre 2014 et cette tour était constamment bombardée. Elle était bombardée avec des systèmes de lance-missiles multiples «Grad», avec des mortiers et tous les combattants étaient allongés par terre, j’avais l’impression que c’était la fin. La tour était tellement secouée que je croyais qu’elle était sur le point de tomber.
Il fallait y montrer par l’escalier, mais courir aussi rapidement qu’on pouvait, car les snipers tiraient tout le temps. Tu cours de toutes tes forces en gilet pare-balles, en casque. Et après tu commences à avoir froid. Car tu y restes durant toute la nuit, c’est affreux : plus rien ne te sauve du froid et tu as vraiment mal. Tu arrêtes de penser, tu n’arrives pas à dormir. Le film ne contient pas les cadres tournés là-bas, juste le bruit, le bruit des bombardements.
Quelle a été la réaction du public lors du festival des documentaires à Amsterdam?
Alisa: La salle était pleine, les gens ont apprécié le film. Un homme est venu me voir. Il m’a dit que son coiffeur est originaire d’Ukraine et qu’il s’inquiète de savoir quand la guerre se terminera. Il m’a demandé si je savais. Je lui ai répondu que, malheureusement, je ne pouvais pas le savoir. Il est devenu tout triste et il a dit : «Qu’est-ce que je dirai à mon coiffeur alors? ».
Votre film a été montré à Moscou lors du festival Artdocfest. Quelles sont vos impressions?
Alisa: À Amsterdam, j’ai rencontréé Vitaly Mansky, organisateur d’Artdocfest, il m’a demandé si je viendrai. J’avais des doutes, car je pensais que cela pourrait être dangereux. Car dans le film il y a la scène dans laquelle je tire à la Kalachnikov en étant avec les combattants du Secteur Droit. En Russie, le Secteur droit est interdit.
Mais, finalement, tout s’est bien passé à Moscou. Nous avons rencontré des personnes comme nous, nous nous entendions parfaitement bien.
Un épisode m’a surprise. Le 12 décembre, le Jour de la Constitution, je suis allée à un rassemblement d’opposition la «Marche des changements» à Moscou. Ce jour-là, plus de 70 personnes ont été arrêtées et mises dans des camions anti-émeute de la police. Elles devaient marcher dans les rues de Moscou, mais on les a arrêtées avant même qu’elles ne commencent à avancer.
Quand je suis arrivée au rassemblement légèrement en retard, il ne restait qu’un petit groupe de personnes. Je suis partie avec elles au commissariat pour apporter à manger à ceux qui avaient été arrêtés. Il s’est avéré qu’un homme âgé est venu d’Ukraine à ce rassemblement. C’est-à-dire, qu’il est venu d’Ukraine à Moscou pour participer à ce rassemblement. Cela m’a surprise. Les femmes portaient des rubans aux couleurs de l’Ukraine. J’ai été aussi étonnée que les gens soient conscients que dès qu’ils allaient aux rassemblements, ils se faisaient enfermer dans des camions anti-émeute, mais ils continuent à sortir. Tant qu’en Russie il y a des festivals comme Artdocfest et des gens prêts à aller aux rassemblements, il y a de l’espoir.
Lubov : J’ai été surprise par autre chose. J’ai fait le voyage aller–retour en Russie dans un bus de Kharkiv. Alors que je revenais de Moscou à Kharkiv, j’ai traversé la frontière à pied. C’était beaucoup plus simple et plus rapide : la file d’attente des bus est très longue, donc, c’est plus rapide d’aller à pied et de prendre ensuite un taxi jusqu’à Kharkiv. Donc, en passant la frontière du côté russe, j’ai demandé à un garde-frontière si j’allais dans la bonne direction. Il a fait un signe dans la direction de l’Ukraine et il m’a dit : «C’est la bonne direction. L’Europe est par là ».